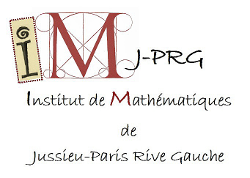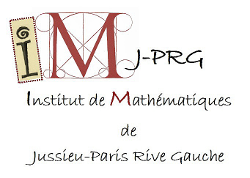| Résume | R. Tazzioli : Le calcul vectoriel en Italie au début du XXe siècle. Notations, recherche, enseignement
Vers la fin du XIXe siècle, il était urgent de trouver des notations communes dans diverses disciplines des mathématiques et de la physique, en particulier dans le cas du calcul vectoriel. En Italie, Cesare Burali-Forti et Roberto Marcolongo s'attelèrent à cette tâche et publièrent cinq articles dans les Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo en 1907-1908, où ils proposaient leur propre système de notations, appelé le « système minimum ». Ces notations furent présentées lors de deux Congrès Internationaux des Mathématiciens successifs, à Rome en 1908 et à Cambridge en 1912. Toutefois, les congressistes ne se mirent pas d'accord sur une notation vectorielle commune, et le déclenchement de la guerre interrompit ce débat.
Mon exposé a pour objectif de montrer comment la recherche d'une bonne notation a été le moteur qui a poussé Burali-Forti et Marcolongo à entreprendre une série d'initiatives. Tout d'abord, ils publièrent deux ouvrages importants sur le calcul vectoriel en 1909, le premier ayant été traduit en français l'année suivante et devenant rapidement une référence (Éléments de calcul vectoriel avec de nombreuses Applications à la Géométrie, à la Mécanique et à la Physique mathématique, Hermann, 1910). Ensuite, leur travail fut à l'origine de la constitution d'un véritable groupe de mathématiciens, appelés les « vectorialistes », qui se revendiquaient de l'école de Peano et partageaient certaines idées fondamentales concernant la recherche et l'enseignement du calcul vectoriel. Les nombreux travaux de ce groupe sont cités dans divers ouvrages français (ceux de G. Bouligand, P.C. Delens, et d'autres), qui ont à leur tour inspiré les idées des Bourbakistes.
L'exposé s'intéressera également aux stratégies de diffusion adoptées par les vectorialistes, qui cherchaient à remplacer le calcul tensoriel, jugé trop analytique car opérant sur des coordonnées, par leur calcul des homographies, lequel, en opérant directement sur les objets géométriques, respectait les idées de Peano et constituait un pur calcul géométrique.
Sabrina Bonfim : Histoire du Calcul Vectoriel dans les relations entre le Brésil et la France au cours des trois premières décennies du XXe siècle.
Plongeant dans l'histoire des sciences, cette étude met l'accent sur la mathématique et leur histoire. En particulier, elle se concentre sur l'histoire de mathématique au Brésil. Cela inclut les figures et œuvres notables qui ont contribué de manière significative au développement de cette science. La présente proposition vise à fournir des éclairages historiographiques sur l'histoire du calcul vectoriel au Brésil. Les données de recherches antérieures montrent que cette discipline a été introduite pour la première fois au Brésil en 1926. Cela a eu lieu à l'École Polytechnique de São Paulo. Le professeur du cours était l'ingénieur-mathématicien Theodoro Augusto Ramos (1895-1935). Ramos fut également l'auteur du premier ouvrage publié dans le pays (1927) et de la première publication internationale par un Brésilien sur le sujet (France, 1930). Ces œuvres ont été analysées et publiées, accompagnées de la biographie académique et professionnelle de Ramos, enrichie de faits personnels jusque-là inconnus dans l'histoire des mathématiques brésiliennes. L'analyse des deux œuvres de Ramos a révélé, entre autres aspects, une forte influence de la tradition des auteurs italiens, en particulier Burali-Forti et Marcolongo, ainsi que des échanges scientifiques avec des chercheurs français. Contemporain des travaux du Brésilien Ramos, une publication en France en 1923 par Albert Châtelet (1883-1960) et Joseph Kampé de Fériet (1893-1982) portait sur le même sujet. À cet égard, ce travail vise à présenter une étude conjointe préliminaire de ces œuvres, ouvrant la possibilité d'approfondir notre compréhension de l'état du calcul vectoriel dans les deux pays, y compris leurs similitudes et différences. Cela conduit à une réflexion sur les relations scientifiques établies entre les deux pays au cours des trois premières décennies du XXe siècle. Il s'agit d'une recherche qualitative, et le cadre théorique méthodologique proposé est basé sur les réflexions de Ricoeur sur l'herméneutique narrative (2007, 2010).
|